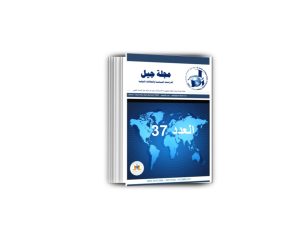La faisabilité du libéralisme politique et l’adoption d’une économie de marché en Algérie –Défis et obstacles–
Dr BENGHARBI MILOUD maitre de conferences classe –A- Faculté de droit et de sciences politiques université de Djelfa.
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 17 الصفحة 117.
Introduction :
Depuis les années 1990 l’Algérie a entamé d’importantes réformes politiques et économiques son évolution par la suite fut marquée dans la sphère politique par la tentative de mettre en place un système politique multipartite. Le processus institutionnel fut rétabli à travers la tenue d’élections régulières. Mais l’Algérie a évolué vers ce qu’on peut qualifier de démocratie de façade , un système qui n’est ni un État autoritaire à part entière, ni une démocratie viable. et sur le plan de l’économie ,rien n’a changé depuis ,si ce n’est quelques déclarations de bonne intention et des promesse sans lendemain .Pour illustrer cette assertion on dit que l’option” tout hydrocarbure ” est encore celle choisie par l’équipe au pouvoir et les privatisations ,actuelles ,n’ont pas mené à une relance des exportations hors hydrocarbure . L’objet central donc de cette étude est de mettre en évidence l’importance du liberalisme politique et l’adoption d’une économie de marché en Algérie .et le fil conducteur de cette réflexion renvoie en premier lieu aux défits et obstacles . Et cela dans les trois chapitres suivants :
le premier chapitre explique comment la politique et l’économie sont deux faces d’une même pièce même en Algérie ? et le deuxième chapitre sera consacré à : l’aspiration à l’ouverture démocratique et le liberalisme politique en Algérie : les enjeux et les obstacles?.et on va connaître les mécanismes de transition économique dans le dernier chapitre : De l’économie administrée à l’économie de marché en Algérie :les defits et les obstacles?
1/ la politique et L’économie :deux faces d’une même pièce même en Algérie
En fait, la politique et l’économie sont deux faces d’une même pièce et sont nées historiquement en même temps. Le dépérissement des catégories de la valeur, du travail, du capital, de l’argent, du crédit, la concurrence, l’individualisme, dans la période de transition vers le socialisme entraînera en même temps le dépérissement des catégories du droit bourgeois et de l’État capitaliste et non l’apparition de nouvelles catégories juridiques prolétariennes et d’une dictature du prolétariat. C’est quand une nouvelle forme de vie collective émergera, que, corrélativement une autre forme de politique. 1
la politique économique comme l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’Etat pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé dans le but d’améliorer la situation économique générale du pays. Plusieurs raisons peuvent justifier l’intervention de l’État dans la sphère économique, parmi lesquelles la nécessité de maintenir la cohésion sociale, l’équilibre des marchés ou le libre exercice de la concurrence 2 et la tache de l’économiste dans ce cas consiste à décrire , à mettre en perspectives les évolutions de la production ,de l’emploi,des prix ,et des taux d’ l’intérêt d’un ensemble de grandeur analogue . 3
Les interactions économico-politique sont au moins aussi importante dans les pays en développement comme l’Algerie que dans les pays industrialisés .Une situation politique instable peut faire fuir les capitaux et les hommes,avec des conséquences très sensible sur le taux de croissance et le taux d’inflation .De même on ne peut comprendre la gestion généralement très déficitaire des entreprises publique que si l’on fait intervenir les considérations politique ,Inversement des mesures économique peuvent avoir d’importantes conséquences politique 4 Certains plans d’ajustement trop sévère et /ou mal conçu ont provoqué de grave troubles sociaux sources de répression et de changements gouvernementaux,en l’absence de l’élection équitables et transparentes les grèves sont des moyens privilégiés pour influencer la politique 5 .
Les analyses sur les interactions entre la nature du régime politique, sa stabilité et le développement économique, aboutissent à des résultats qui restent souvent perplexes tant sur l’existence d’une corrélation que sur le sens des causalités. Concernant l’existence d’une corrélation entre la nature du régime politique et le
développement, l’hypothèse selon laquelle la démocratie aurait des coûts en termes de croissance ou serait un stimulant ne semble pas évidente. Quant au lien entre la stabilité du régime politique et le développement, les recherches parviennent à dégager des résultats plus probants, sans toutefois déboucher sur un schéma déterministe politique ou économique solide.6 Au point que le modèle type standard de système n’existe pas, ni pour le capitalisme ni pour le socialisme. Ce qui existe ce sont des variétés ou formes structurelles de système socio-économique, par delà un contenu social fondamental et invariant. Le socialisme et le capitalisme sont toujours construits aux couleurs nationales 7
Pourtant le libéralisme économique affirme que l’économie de marché est supérieure en termes d’efficacité, de création de richesse et de croissance à un système dans lequel l’économie est régie par l’état, son cas extrême étant l’économie planifiée, ou à un système dans lequel les rôles économiques sont transmis héréditairement d’une génération à l’autre 8 De l’autre coté Le libéralisme politique, c’est une vision des valeurs et des institutions indispensables à la protection des libertés publiques et des droits individuels.
On peut donc identifie quatre grands traits caractéristiques du libéralisme comme philosophie politique qui se manifestent à divers égards dans les pratiques, institutions et idéaux des sociétés libérales
actuelles :
– Premièrement, le libéralisme assume que les individus ont une valeur morale intrinsèque et qu’ils doivent être considérés libres et égaux du point de vue politique. En ce sens, et en ce sens seulement, il s’agit d’une doctrine individualiste.
– Deuxièmement, les individus sont détenteurs d’un ensemble de droits inaliénables, comme le droit de parole, de religion, d’association, de conscience et de propriété matérielle.
– Troisièmement, les individus doivent jouir d’une opportunité égale d’accéder aux positions et bénéfices sociaux.
– Quatrièmement, l’État est neutre à l’égard des conceptions du bien et choix individuels (acceptables dans les limites du droit). Les lois et politiques publiques ne devraient donc pas être partisanes et devraient être susceptibles d’être approuvées par toute personne raisonnables 9
2/ l’aspiration à l’ouverture democratique et le liberalisme politique en Algérie : les enjeux et les obstacles
Le liberalisme politique et l’ouverture démocratique du système algérien n’est plus seulement une exigence sociale et politique exprimant une volonté d’alternance générationnelle naturelle. Elle devient chaque jour davantage un impératif de sécurité nationale et un besoin social urgent et nécessaire.
Quoi qu’il en soit, la perpétuation du système actuel n’ira pas sans écueil si le peuple ne perçoit toujours pas un fonctionnement légal des institutions. En d’autres termes, le peuple a besoin de droit, de sang neuf, de perestroïka, d’une nouvelle chrysalide plus que jamais. Il ne pourrait accepter après plus de vingt années d’exercice du pouvoir personnel une nouvelle forme édulcorée d’autoritarisme qui lui rappellerait les travers du régime à parti unique, avec toutes les conséquences que l’on connaît. En effet, le résultat qu’il faut obtenir désormais n’est plus celui de la paix civile coûte que coûte, de l’arrêt de l’effusion de sang mais celui d’une nouvelle paix sociale et économique qui valorise droit et démocratie 10
l’absence de concertation démocratique et de libre débat. Les décrets pris d’en haut, de manière bureaucratique, sollicitent une discipline nationale ou un conformisme aveugle, ce qui en atténue le sens et la portée, en particulier auprès de ceux qui ne participent pas aux décisions : les femmes, les jeunes et les marginalisés exclus de la vie économique et sociale11.
L’arrivée dans la vie active de nouvelles générations, nombreuses, mieux formées et plus exigeantes, la diversification des attentes et des besoins résultant de l’évolution socio-économique ainsi que le malaise social grandissant au cours des années nécessitaient évidemment des “réformes” dans les méthodes de gestion du pays12. À contre-courant des discours triomphalistes et lénifiants du pouvoir, de ses relais et de ses satellites, des voix continuent à considérer que l’Algérie est loin d’avoir achevé sa transition entamée au lendemain des évènements d’octobre 1988. Même si des acquis, non négligeables du reste, comme l’institutionnalisation de tamazight, les droits des femmes, à titre d’exemple, ont été enregistrés par la société algérienne, l’établissement d’une véritable démocratie demeure encore au cœur de la problématique algérienne13
à l´instar de la grande majorité des Etats des pays du Sud, l’Algérie a pris théoriquement conscience de l´indispensable développement des organisations de la société civile. Tout au long des décennies post-indépendance, le pouvoir a édicté les ordonnances, lois et règlements nécessaires à la création et au fonctionnement des associations de la société civile. Mais à aucun moment, le pouvoir n´a accepté d´avoir en face de lui une société civile forte, indépendante de lui, constituant un contre-pouvoir puissant et crédible et, en fin de compte, pouvant remettre en cause sa légitimité 14
Malgré une présence numérique pléthorique, la société civile reste faible, au mieux embryonnaire. Aussi s’apparenterait-elle davantage à un objet qu’à un sujet social. À ce titre, cette situation serait, en premier lieu, le résultat d’une conjonction de facteurs impactant, à un degré ou à un autre, l’efficacité des organisations non gouvernementales. Ces facteurs inhérents au corps des associations ne sont, toutefois, pas le seul facteur explicatif. Le deuxième facteur à examiner est le contexte politique dans lequel ces associations sont créées, puis évoluent. Un contexte marqué par la résilience du système politique algérien 115.
Parallèlement a l’absence d’une societé civile forte et efficace l’opposition politique réprimée est tout aussi fragile tant en ce qui concerne son implantation que ses capacités de mobilisation. Les projets des partis ou mouvements politiques d’opposition sont embryonnaires, sommaires et mal connus116. sous l’empire de l’état totalitaire les activités des partis politiques sont pratiquement gelées. C’est dire qu’au regard des faits, il est encore difficile de parler d’un processus démocratique en Algérie. L’ouverture démocratique algérienne semble plutôt évoluer vers les chimères . En Algérie aujourd’hui l’armée est à la recherche des gestionnaires d’un système politique encore mal défini et dont elle sait seulement qu’elle doit garder les principales commandes. 117 La fragilité des libertés reconnues en Algérie, et la faiblesse des partis d’opposition et les graves atteintes aux droits de l’Homme qui y sont signalées par les organisations humanitaires indiquent les limites de la démocratie et le libéralisme politique en Algérie 118.
Le système a voulu entretenir l’illusion d’un changement là où la réalité est marquée par la continuité dans la répression, les violations des libertés publiques et des droits de l’Homme. Les citoyens qui revendiquent le respect de leurs droits aussi bien civils et politiques, qu’économiques, sociaux et culturels font l’objet de discriminations, d’arrestations les revendications sociales sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses, et d’importantes manifestations pour réclamer le liberalisme politique et l’amélioration du niveau de vie119.
3/ De l’économie administrée à l’économie de marché en Algérie :les defits et les obstacles
Le passage vers l’économie de marché a été un chemin de croix, surtout pour un pays comme l’Algérie qui avait tenté de grandir a l’ombre du socialisme.L’engagement résolu du pays dans la voie du libéralisme a libéré les énergies privées, et une forte dynamique économique s’est enclenchée se caractérisant par un développent du secteur privé dans un cadre encore en transformation. L’émergence d’une culture entrepreneuriale s’est avérée difficile, du fait que la propriété privée était auparavant vue comme un symbole du capitalisme colonial. Ceci s’est traduit dans les faits par de multiples obstacles auxquels sont confrontées les jeunes , qui évoluent encore aujourd’hui dans un environnement particulièrement turbulent, notamment cause d’une transition encore inachevée et d’une intégration rapide dans l’économie mondiale15.
Il est regrettable que en Algérie les responsables aient tendance à ne libéraliser l’économie que sous la contrainte. Bien que certaines réformes puissent entrer en vigueur assez rapidement, d’autres demandent du temps et doivent s’accompagner de mesures complémentaires pour en atténuer les effets. En matière de réformes, il est donc préférable d’agir sans tarder 16
Certainement la nouvelle stratégie de l’Etat est la mise en œuvre des politiques de libéralisation et la volonté définitive de rupture avec les méthodes du passé., l’action de l’Etat, cette fois-ci, s’inscrit dans la logique de la diminution du rôle du secteur étatique et de ses entreprises. Le poids du secteur non étatique se renforce d’un côté par la création de nombreuses entreprises privées et d’un autre côté par la privatisation du secteur étatique. Au-delà des différentes vagues et modalités de privatisation que les différents gouvernements de la décennie ont connue17
Dès le départ de la restructuration et de l’autonomie de l’entreprise étatique, les réformateurs ont eu une vision institutionnelle et juridique globale des changements de contexte économique et financier à apporter mais ayant fait défaut aux autres expériences de réformes. Leur but est de fixer les règles de fonctionnement des différents intervenants dans l’économie par une série de lois et de décrets d’application et ce, dans la plus grande transparence possible et non pas – comme on aurait pu s’y attendre – d’agir ponctuellement et directement sur tel ou tel élément du système 18
Au cours des dernières années, l’Algérie a enregistré de bonnes performances économiques, qui se sont traduites par une consolidation du cadre macro-économique. L’économie est cependant tributaire du secteur des hydrocarbures et demeure très sensible
aux chocs extérieurs19.
L’Algérie compte parmi les principaux pays exportateurs d’hydrocarbures. C’est le quatorzième exportateur de pétrole au monde et elle fournit 20% des besoins en gaz naturel de l’Europe. Le secteur des hydrocarbures domine l’économie, représentant en moyenne sur les dernières années 43% du PIB, 98% des exportations et 75 % des recettes budgétaires20
Pourtant La rente pétrolière a détruit le savoir-faire local, fait naître des attentes de consommation, entretenu l’illusion de la richesse et marginalisé les investissements dans le capital humain21. Les obstacles au développement peuvent s’interpréter par l’absence de convergence entre distribution des rentes économiques et du pouvoir politique dans un contexte et une structure institutionnelle donnés ou en formation.
L’Algérie se classe mauvaise 156e en terme de facilité de faire des affaires, selon le rapport Doing Business en 2017 de la Banque Mondiale (BM). L’institution internationale a étudié 190 économies à travers le monde, la première place étant la meilleure, cette place fait de l’Algérie l’un des pires pays au monde pour faire des affaires. Malgré qu’elle a gagnée 7 place par rapport à l’année précédente 2016 ou elle occupe la 163 e place, la qualité de son environnement des affaires reste médiocre, en 2015 elle a s’est classée 154e et en 2014 la 147e et en 2009 la 134 place, ainsi en remarque que l’Algérie n’a cesser de perdre de place, ce qui illustre la difficulté accrue qui caractérise l’environnement qu’elle propose aux investisseurs pour investir et faire des affaire22.
La politique économique donc a oscillé, selon la conjoncture, entre le discours de la réforme et le laxisme consistant à laisser filer les déficits. Cette contradiction est à rechercher dans la nature néo-patrimoniale du régime et dans l’hostilité de l’élite aux lois du marché, ce qui explique la difficile naissance d’un champ économique autonome de l’administration23.
Il ne peut y avoir de développement économique sans le recours au marché qui n’a d’efficacité qu’institutionnalisé. En effet, mettre en place des incitations pour la production et l’investissement privés c’est assurer l’essor de l’économie et le bien-être de la population. Le secteur privé joue un rôle déterminant dans la croissance économique certainement dans une économie de marché, ce sont les individus et les groupes composant la société civile qui investissent et produisent, dans la résilience de l’économie nationale par une diversification des activités de production et la baisse de la dépendance à l’égard de ressources naturelles non pérennes 24.
La Conclusion :
Si l’on prétend que la conséquence du libéralisme politique et l’adoption d’une économie de marché en Algérie sont ou doivent être, de favoriser les intérêts particuliers de certaines couches de la société, c’est une question qui mérite d’être discutée. L’une des tâches de notre étude est de montrer qu’un tel reproche n’est en aucun cas justifié. Mais on ne peut pas, a priori, soupçonner de malhonnêteté la personne qui soulève cette question —, bien que nous considérions cette idée comme incorrecte, elle pourrait parfaitement être soutenue avec la meilleure bonne foi du monde. En tout cas, ceux qui attaquent le libéralisme de cette façon concèdent que ses intentions sont désintéressées et qu’il ne veut rien d’autre que ce qu’il dit vouloir.
Il en va assez différemment des critiques qui reprochent au libéralisme et l’ économie de marché de chercher à favoriser non pas le bien- être général mais les intérêts particuliers de certaines classes. De tels critiques sont à la fois malhonnêtes et ignorants. En choisissant ce type d’attaque, ils montrent qu’ils sont au fond d’eux bien conscients de la faiblesse de leur propre cause. Ils utilisent des armes empoisonnées parce qu’ils ne peuvent sinon espérer l’emporter.
Références bibliographiques :
1- Janine Robert: La politique et l’économie capitaliste : deux faces d’une même pièce. [En ligne]: http://www.amis.monde-diplomatique.fr/article5543.html.consulté le 09/05/2018 2- Joëlle Bonenfant et Jean Lacroix : La Notion : La politique économique.chambre de commerce et d’industrie de paris .
Direction de relation internationale et de l’enseignement.p.01
3-. Bernard Jurion : économie politique .4 édition.De boeck supérieur.Bruxelle .Belgique .2014 .p.04 4-Jean-Dominique La fay: Les interactions entre éconmie et politique .Le journale de statistique de Paris .tome 136 n01. 1995. p.25
5-ibid . p . 25
6- Deniz AKAGÜL : DEMOCRATIE, STABILITE POLITIQUE ET DEVELOPPEMENT : ANALYSE DU CAS TURC.Centre nationale des recherches scientifiques.Lile.France .p.01
7- Makhtar Diouf : Economie politique pour l’Afrique .Les Nouvelles Éditions Africaines du Sénégal. Sénégal.1991.p.28
8-.Michel De Vroey; Le libéralisme économique et la crise. “conférence” Université Catholique de Louvain .mai 2009 .France p.02
9- Andrée-Anne Cormier : Le libéralisme politique et l’éducation à l’autonomie individuelle. Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en Philosophie, option recherche.encadré par : Peter Dietsch. Département de philosophie .Faculté des Arts et Sciences. Montréal, 10 décembre 2010.p.06
10-A. K. ; L’Algérie entre succession dynastique et transition démocratique.L’Algerie patriotique.11/09/2017.
11-contribution : pour l ‘honneur de l Algerie Principes fondateurs d’une coordination républicaine pour un changement democratique modern .journal liberte .le 24/05/2018
12 – ibid.
13- k.k: La transition démocratique en Algérie est inachevée” .journal liberte .le 22/05/2018
14-La société civile en Algérie. [En ligne]: http://niar5.unblog.fr/3meteo-politique/la-societe-civile-en-algerie/ consulté le 10/05/2018
115-Louisa Dris-Aït Hamadouche: La société civile vue à l’aune de la résilience du système politique algérien. [En ligne]: https://journals.openedition.org/anneemaghreb/3093#ndla consulté le 11/05/2018
116-Madjid Benchikh: Les obstacles au processus de démocratisation en Algérie. Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°65, 1992. L’Algérie incertaine, sous la direction de Pierre Robert Baduel.paris.p.108
117-ibid.p114
118-ibid.p114
119-Houari Kaddour: Ligue algérienne pour la Défense des droits de l’Homme (Laddh) L’autre accablant rapport sur les droits de l’homme en Algérie en 2017.journal le matin :le 09/12/2017
15 Abdenour MOULOUD: De l’économie administrée à l’économie de marché Politique en faveur de l’investissement privé en Algérie
à la veille du cinquantenaire de son indépendance. Quelques repères historiques.P63
16- 83e Rapport annuel BRI. Lever les obstacles à la croissance.Paris.2013.p.41
17-MOUSSA ZOUAOUI: L’IMPACT DE L’ACTION DE L’ETAT SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN ALGERIE (1962-2000).these de doctorat encadre par :M. N. THABET . UNIVERSITE MENTOURI- CONSTANTINE FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DES SCIENCES DE GESTION .p.210
18- ibid.224
19-Achour Tani Yamna: L’analyse de la croissance économique en Algerie THESE De Doctorat en Sciences Option : Finances Publiques .encadre par : Belmokadem Mostefa. Faculté des Sciences Economiques Commerciale et des Sciences de Gestion. Année universitaire 2013-2014.p.60
20- ibid.p.60
21- Luis Martinez: Algérie : les illusions de la richesse pétrolière.archives–ouvertes. Centre d’études et de recherches internationales N° 168 – septembre 2010
.p.05
22-. MAAFA Dyhia et MADOUI Sonia : Les Obstacles à l’Emergence d’une Economie Diversifiée en Algérie. Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention du diplôme de Master en Sciences Commerciales.encadré par : MAHOUI Karim. Université Abderrahmane Mira de Bejaia Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion Département des Sciences Commerciales 2017.p.33.
23-.Lahouari Addi: Réformes économiques et obstacles politiques . Le Quotidien d’Oran.le 27 juin 2004.
24- A. Khaldi : L’ETAT DÉFAILLANT : LE CAS DE L’ALGÉRIE. El Watan le 29.08.